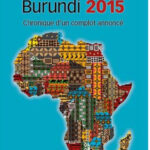Un article déplacé de Sylvestre Ntibantunganya paru sur le site @rib News du 26/01/2016 a augmenté notre questionnement sur la responsabilité des anciens  présidents du Burundi et sur leur conduite de petit-bourgeois peu soucieux de se mettre en question nonobstant les largesses du gouvernement du Burundi.
présidents du Burundi et sur leur conduite de petit-bourgeois peu soucieux de se mettre en question nonobstant les largesses du gouvernement du Burundi.
Le propre du petit-bourgeois est de se faire passer pour un arbitre impondérable qui établit les règles à sa mesure et qui nomme les choses selon des mots qu’il prétend contrôler lui-même en s’assurant qu’il monopolise la raison et la moralité tandis que tous les autres sont complètement dans l’erreur et ne méritent même pas d’être écoutés. Cette prétention de monopole de la grandeur permet au petit-bourgeois de s’établir en justicier, y compris sur le bateau de la politique sur lequel aucun tribunal n’est possible, les juges étant tout aussi bel et bien embarqués que ceux qu’ils s’arrogent le pouvoir de juger, la critique innocente n’étant qu’une hypocrisie à peine voilée.
Avant de s’enliser dans l’amnésie rapide et la cécité précoce, ces ex-Présidents devraient profiter du recul historique qui leur est offert pour revenir en toute humilité sur leur passage à la Magistrature Suprême de leur pays, s’auto-évaluer et s’employer à contribuer positivement au développement durable du pays dont ils continuent d’être les profiteurs privilégiés et insatiables.
Si nous essayons de revenir sur eux un à un nous comprendrons qu’ils sont systématiquement responsables de la situation actuelle et que leur prestation actuelle est aussi lamentable qu’irresponsable.
Jean Baptiste Bagaza

Point n’est besoin d’évoquer comment il est arrivé au pouvoir et comment il y est resté pendant 11 ans. 11 ans de terreur du début à la fin. Un état d’exception permanent. Il ne fallait jamais ouvrir sa bouche, les fameux « mangamatwi » (les hommes aux oreilles grandes ouvertes) étaient omniprésents. Les hutus ne devaient ni recevoir de courrier, ni en envoyer. Surtout pas à l’étranger. Sinon c’était la prison assurée. Et après la prison et la torture, la mort mystérieuse s’en suivait. Déjà en 1979 les survivants du génocide de 1972 ont pris le chemin de l’exil pour échapper au massacre. Ce n’est pas Sylvestre Ntibantunganya qui nous contredirait ici. On ne pouvait pas lire ce qu’on voulait. Surtout pas La Vérité sur le Burundi de Boniface Kiraranganya. Encore moins L’Hiver sur le Lac Tanganyika de Nadine Nyangoma. Combien de personnes ont été emprisonnées pour avoir lu un numéro du journal Jeune Afrique que Bagaza ne voulait pas?
Dans une conférence publique, quelqu’un a posé cette question à un de ses anciens ministres, Balthazar Habonimana : « pourquoi vous venez aujourd’hui nous raconter des histoires alors que vous étiez membre du gouvernement et que vous pouviez conseiller à Bagaza d’arrêter de maltraiter le peuple ? ». Il a répondu : « quand un lion entreprend de manger les brebis, le mieux à faire pour le berger n’est pas de s’exposer, c’est d’attendre le bon moment pour le mettre hors d’état de nuire ». Dans la même logique, lors d’un de ses derniers conseils des ministres, Bagaza demande à ses ministres quelle était sa côte de popularité dans le pays. Les ministres lui répondent tous que les burundais l’aimaient tellement qu’ils pourraient mourir à sa place. Il n’y a eu que feu Cyrille Barancira qui a osé lui dire la vérité en jurant sur le nom de sa mère que personne ne le sentait, y compris ses ministres. Pour décrire le régime de terreur de Bagaza, il faudrait écrire beaucoup de livres. Lorsqu’on l’a vécu, on s’efforce en vain de l’oublier, tellement les stigmates sont ineffaçables. Même au retour de l’exil, il n’avait pas changé. Sa prestation comme président du PARENA, un parti politique sectaire qu’il a fondé en dit long. Il aura fallu que les burundais lui montrent, par la voie des urnes, que son idéologie ne vaut rien pour qu’il s’en rende compte. C’est pourquoi il hait les élections.
Lorsque cet homme si pervers ose aujourd’hui donner des leçons de démocratie au Président Pierre Nkurunziza, nous croyons que cela est particulièrement déplacé. Comment donc un ex-président, officier en retraite de l’armée, peut-il soutenir un projet d’invasion de son pays alors qu’en 1998 il ne voulait même pas entendre parler de forces étrangères ? Comment celui qui prêchait dans un discours officiel que « uza guhonya igiti nyamwinshi agihera mu mashami » (Pour anéantir définitivement un gros arbre, on commence par les branches) ose – t- il vendre un génocide imaginaire alors qu’il l’a pratiqué systématiquement en tant que mode de gouvernance ? Que dire de sa fameuse politique de « i » et « u » pour discriminer les tutsis et les hutus de telle façon que les hutus ne devaient pas accéder à l’enseignement secondaire ? Comment Bagaza peut-t-il expliquer que certaines facultés de l’Université du Burundi, comme la Faculté de Droit, n’étaient réservées qu’aux seuls tutsis ? Et les listes des intellectuels hutus qu’il avait sur son bureau, que voulait-il en faire ?
Il est vrai qu’on aime lui attribuer des réalisations de développement, et cela est juste dans une certaine mesure. Il aura bénéficié d’un environnement international qui lui était favorable. Mais il faut souligner qu’il n’a pas oublié de se développer lui-même en se dotant de toute une rue du centre de la ville et d’autres palais et propriétés que tout le monde connaît. Malheureusement il a été renversé par un homme encore plus méchant que sanguinaire que lui qui continue encore aujourd’hui à endeuiller le Burundi.
Pierre Buyoya, le Gustave burundais.

Ce neveu de Micombero avait été préparé pour poursuivre les forfaits de ce dernier si Bagaza n’était pas tombé sur la scène comme un cheveu dans la soupe. Il n’est pas du tout difficile de comprendre la position de cet auteur du Coup d’Etat impossible par rapport à la démocratie. Lors de sa dernière campagne pour briguer le post de Secrétaire Général de la Francophonie, il n’a pas hésité à soutenir devant le monde entier que « ce qui importe ce n’est pas la manière dont on arrive au pouvoir ; c’est la manière d’en sortir ». Pour lui tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir et pour le garder. Mais cela n’est valable que pour lui seulement. Sinon son agitation actuelle n’aurait aucun sens.
Cela dit, il est quand même important de constater que Buyoya reste cohérent et persistant dans son idéologie criminelle. Il n’a pas froid au dos, il ne perd aucune seconde tout comme il ne se lasse jamais, et il tue indistinctement.
Déjà en 1988, lorsqu’il largua le napalm sur les populations innocentes de Ntega et de Marangara, il ne s’est rendu compte de sa folie meurtrière que lorsque un paysan désespéré, poussé à l’extrême tenta de descendre l’avion dans lequel se trouvait Buyoya en usant d’une simple flèche : un geste de grand désespoir. 50.000 innocents ont été liquidés, d’autres emprisonnés, des centaines de milliers d’autres ont pris le chemin de l’exil. C’était effroyable.
Lorsqu’un groupe d’intellectuels hutus excédés par cette horreur ont osé lui écrire une lettre ouverte, ceux qui ne sont pas parvenus à fuir ont croupi en prison pour avoir osé s’exprimer. Le demeurant pourrait à ce niveau faire la comptabilité des lettres ouvertes qui ont déjà été envoyées au Président Pierre Nkurunziza par diverses personnes et organisations qui n’ont jamais été inquiétées.
En 1991, sous prétexte d’une attaque du PALIPEHUTU, Buyoya a liquidé des milliers d’intellectuels hutus pour essayer de freiner l’avènement du multipartisme et de la démocratie.
Nous ne voulons pas parler des disparitions de vailants officiers de l’armée burundaise tels que Ndakazi, Sizoyiheba, Ntako, Nonahavuye, Hakizimana, Rududura et beaucoup d’autres que Buyoya a éliminés froidement pour demeurer au pouvoir. L’assassinat du Président Melchior Ndadaye accompagné par la décapitation totale des institutions de la République, les assassinats sélectifs des élus du FRODEBU, la purification ethnique de certains quartiers de Bujumbura ont été suffisamment évoqués même s’ils ne peuvent l’être assez. Ce génocide rampant qui a été déclenché en 1993, qui a culminé par le coup d’Etat de juillet 1996 et qui s’est poursuivi jusqu’en 2003 est encore frais dans toutes les mémoires et ses conséquences sont à la base de la crise actuelle.
Lorsque Buyoya ose prendre la parole pour donner des leçons de démocratie au monde et au Burundi nous croyons que c’est tout simplement du cynisme. S’il n’est pas en mesure de prendre les conséquences de ses actes, il faudrait tout au moins qu’il comprenne le rejet que la communauté francophone et internationale lui a opposé lorsqu’il a tenté de la narguer en voulant devenir Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie. La communauté internationale dont il n’a eu peur d’assassiner les ressortissants (l’OMS le sait bien avec Kassim Manlan) devrait se rendre à l’évidence : là où Buyoya est l’Envoyé Spécial, il ne peut pas y avoir de paix. Impossible. En réalité sa place se trouve à la CPI à la Haye.
Lors de sa dernière sortie médiatique pour parler d’un génocide imaginaire au Burundi, son pays, et de la nécessité d’une force d’invasion pour venir humilier l’armée dont il a été le Commandant Suprême, nous avons bien suivi son argumentation. Il a dit que : ce qui importe ce n’est ni la vérité, ni les indices vérifiables, ni les faits réels, c’est ce qui n’est pas dit, ce qui n’est pas fait et ce qui ne se fera même pas. Allez-y comprendre.
Certains analystes aiment lui attribuer une politique d’unité nationale et une passation pacifique du pouvoir. Pourtant il n’en est rien. Il s’est toujours soumis à la pression internationale qu’il appelait la quatrième ethnie du Burundi et il est toujours parti sans le vouloir en préparant son retour dans un bain de sang. C’est ça qui lui a valu son surnom si bien choisi : Gustave, le crocodile burundais.
Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye.
Nous préférons mettre ces deux ensemble pour épargner le temps du lecteur.
Le fait est qu’ils n’ont rien fait que nous pourrions souligner. Franchement nous ne savons pas grand-chose sur ce qu’ils ont fait pour mériter de s’appeler anciens présidents. L’un était prisonnier de Buyoya, l’autre était son employé de maison. Aujourd’hui encore. Ils font ce qu’il leur dit de faire.
Minani Claver