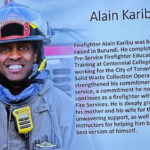Introduction.
Le Burundi s’est engagé depuis plus d’une décennie dans un processus d’intégration économique régional et continental pour stimuler son développement. Il a adhéré à la Communauté d’Afrique de l’Est (East African Community, EAC) en 2007 et a rejoint l’Union douanière de l’EAC en juillet 2009. Concrètement, cela signifie que le Burundi applique le tarif douanier commun de l’EAC et bénéficie de la libre circulation des marchandises à l’intérieur de ce bloc régional. Parallèlement, le pays participe à la dynamique continentale avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont il a signé l’accord en 2018 et qu’il a officiellement ratifié le 17 juin 2021. L’objectif de ces initiatives est d’intégrer le Burundi dans de plus grands marchés, de faciliter les échanges commerciaux et d’accroître la croissance économique. L’EAC compte aujourd’hui sept pays membres (dont la RDC depuis 2022), représentant plus de 300 millions d’habitants. Quant à la ZLECAf, une fois pleinement opérationnelle, elle constituera le plus vaste marché commun au monde en nombre de pays participants, couvrant 1,2 milliard de personnes, avec pour ambition de booster de 35 milliards de dollars les échanges intra-africains et d’augmenter de 6 % les exportations du continent. Dans ce contexte, l’intégration du Burundi soulève de grands espoirs en matière d’accès aux marchés et de croissance, tout en posant des défis d’ajustement pour l’économie nationale.
Avantages de l’adhésion à l’EAC et à la ZLECAf
L’intégration du Burundi à l’EAC et à la ZLECAf lui procure plusieurs avantages économiques potentiels. D’abord, l’adhésion à l’EAC offre un accès privilégié à un marché régional élargi sans barrières tarifaires internes. Les entreprises burundaises peuvent théoriquement exporter leurs produits vers des pays voisins (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Sud-Soudan et RDC.) sans droits de douane, ce qui accroît leurs débouchés. De plus, la communauté de l’EAC a mis en place des mesures de facilitation des échanges (guichets uniques aux frontières, harmonisation partielle des normes) qui réduisent les coûts et délais du commerce intrarégional. L’ouverture de ce marché de plus de 300 millions de consommateurs est un atout pour stimuler la production locale et attirer des investissements, en particulier dans les secteurs où le Burundi dispose d’un avantage comparatif.
Au niveau continental, la ZLECAf constitue une opportunité encore plus vaste. Elle prévoit l’élimination progressive des droits de douane sur 97 % des produits échangés entre les pays africains, ainsi que la libéralisation de certains secteurs de services. Selon les analystes, cet accord va considérablement élargir l’horizon commercial du Burundi. En effet, « la ZLECAf élargira le marché préférentiel des produits burundais au-delà de l’EAC et du COMESA », permettant au pays de commercer à des conditions avantageuses avec d’autres États africains.
Concrètement, le Burundi pourra exporter vers l’Afrique de l’Ouest, australe ou du Nord en bénéficiant de tarifs réduits ou nuls, ce qui diversifiera sa clientèle au-delà de sa région immédiate. Les études prospectives augurent des effets positifs notables : la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA), en partenariat avec TradeMark East Africa, estime que la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait entraîner une hausse de 1,1 milliard de dollars du commerce interrégional en Afrique de l’Est et la création de plus de 2 millions d’emplois dans la région. Cette libéralisation devrait aussi encourager la diversification économique et la montée en gamme industrielle. Par exemple, la CEA projette un doublement des exportations est-africaines de produits textiles et une expansion significative des secteurs de l’agro-transformation et de la fabrication légère grâce à l’accès à de nouveaux marchés continentaux.
En résumé, en rejoignant ces blocs, le Burundi peut tabler sur des opportunités commerciales accrues, une amélioration de l’accès aux marchés régional et continental, une facilitation des échanges via la réduction des barrières, et in fine une stimulation de sa croissance économique à moyen terme, sous réserve de surmonter les défis d’adaptation.
Données chiffrées récentes sur le commerce du Burundi
Les tendances récentes du commerce extérieur du Burundi reflètent à la fois les premiers effets de son intégration régionale et le chemin qu’il lui reste à parcourir. L’Afrique constitue un débouché majeur pour le Burundi : en 2022, les exportations du pays vers l’ensemble du continent ont atteint environ 68,1 millions de dollars, soit près de 35 % des 195,5 millions de dollars d’exportations totales réalisées cette année-là.
Ce poids important du marché africain est cohérent avec les chiffres antérieurs (en 2020, environ 38 % des exportations burundaises étaient déjà destinées à l’Afrique. Au sein de ce commerce africain, l’espace EAC occupe une place prépondérante. D’après les statistiques de l’East African Business Council, les exportations du Burundi vers les pays de l’EAC sont passées d’environ 51 millions $ en 2021 à 55,3 millions $ en 2022, soit une progression de +8,4 % sur un an.
Cette croissance dénote une intensification des échanges régionaux post-pandémie. La République démocratique du Congo (RDC) qui a rejoint l’EAC en 2022 est devenue la première destination des produits burundais, représentant à elle seule 38,7 millions $ des exportations en 2022, suivie de la Tanzanie avec 9,9 millions $. Les autres partenaires de l’EAC (Kenya, Ouganda, Rwanda, Sud-Soudan) absorbent le reliquat.
Du côté des importations, le Burundi s’approvisionne également en grande partie auprès de ses voisins africains. En 2020, environ 28 % de ses importations totales provenaient du reste de l’Afrique, un chiffre qui inclut surtout les achats en EAC et au sein du COMESA. Les principaux produits importés par le Burundi depuis la région sont le ciment, les carburants, les engrais chimiques et divers produits manufacturés de consommation courante.
À l’inverse, la structure des exportations burundaises vers l’Afrique demeure dominée par quelques produits traditionnels. En 2020, les principales marchandises exportées vers les pays africains comprenaient le café et le thé (produits phares de l’agriculture burundaise), les produits de minoterie (farines et céréales transformées), ainsi que des boissons. Ces chiffres illustrent la spécialisation encore limitée de l’économie burundaise. Néanmoins, on observe récemment l’émergence de produits manufacturés légers dans la liste des exportations régionales (par exemple des savons, des eaux minérales, des bières fabriquées localement figurent parmi les biens exportés vers les pays voisins, signe que de petites industries locales commencent à tirer parti du marché élargi. Malgré la hausse des exportations, le Burundi enregistre un déficit commercial vis-à-vis de ses partenaires de l’EAC, ses importations depuis la région excédant la valeur de ses exportations, un phénomène courant pour une économie en développement qui importe des biens d’équipement et manufacturés tout en exportant principalement des matières premières agricoles.
Impact sur les PME burundaises
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent le cœur du tissu économique burundais, représentant plus de 90 % des entreprises du pays (incluant le secteur informel). Leur intégration dans ces marchés élargis est donc cruciale pour que les bénéfices de l’EAC et de la ZLECAf se concrétisent au niveau local. Du côté des opportunités, l’ouverture des frontières offre à ces PME la possibilité d’élargir leur clientèle au-delà du marché domestique très restreint (12 millions d’habitants peu solvables). Un petit producteur de denrées alimentaires ou d’artisanat, par exemple, peut désormais envisager d’exporter vers les pays voisins sans barrières tarifaires, ce qui était auparavant difficile. De même, les PME peuvent profiter d’une importation facilitée des intrants (matières premières, machines) bon marché en provenance de la région, améliorant potentiellement leurs coûts de production. La ZLECAf pourrait ainsi permettre à certaines jeunes entreprises burundaises innovantes de trouver des débouchés sur tout le continent et de réaliser des économies d’échelle impossibles sur le seul marché national. Les responsables de la CEA soulignent d’ailleurs que « tout le monde y gagnera, y compris les petites et moyennes entreprises » grâce à la libéralisation commerciale africaine.
Cependant, pour de nombreuses PME burundaises, ces opportunités s’accompagnent de défis de taille. D’une part, la concurrence va s’intensifier : les entreprises locales doivent désormais rivaliser avec des producteurs des pays voisins (Kenya, Tanzanie, Ouganda…) souvent plus compétitifs, disposant de coûts de production moindres ou d’une meilleure capacité à satisfaire les normes de qualité régionales. Cela peut être particulièrement difficile pour les micro-entreprises artisanales ou agro-industrielles burundaises, qui risquent de se voir évincées du marché intérieur par des produits importés bon marché. D’autre part, les PME du Burundi font face à des contraintes internes qui limitent leur aptitude à tirer pleinement parti de l’intégration. On peut citer le faible accès au financement : le crédit aux petites entreprises est limité et coûteux, ce qui bride leurs investissements et leur montée en capacité, un problème majeur qui entrave le développement du secteur privé à tous les niveaux.
S’y ajoutent un déficit technologique et d’innovation : la plupart des PME utilisent des procédés peu modernes et peinent à adopter de nouvelles technologies, ce qui affecte leur productivité.
De plus, la maîtrise des procédures d’exportation (documents douaniers, règles d’origine, etc.) reste faible parmi ces petites structures, souvent peu informées des exigences à l’étranger. Sans accompagnement, beaucoup risquent de ne pas pouvoir profiter concrètement des nouveaux marchés ouverts. En somme, les PME burundaises se trouvent à un tournant : l’intégration régionale et continentale leur ouvre des perspectives inédites de croissance, mais pour en bénéficier elles devront relever le défi d’améliorer leur compétitivité, de se conformer aux standards internationaux et de surmonter les obstacles structurels (financement, technologies, qualité) qui les limitent aujourd’hui.
Secteurs les plus touchés par l’intégration régionale et continentale
L’intégration du Burundi dans l’EAC et la ZLECAf n’affecte pas tous les secteurs économiques de manière uniforme, certains en tirent clairement parti, tandis que d’autres subissent davantage de pressions concurrentielles.
Secteurs potentiellement gagnants : plusieurs filières burundaises devraient bénéficier de l’élargissement des marchés et de la libéralisation des échanges. Les analyses nationales ont identifié une série de secteurs où le Burundi dispose d’atouts compétitifs à valoriser dans le cadre de la ZLECAf :
- Agriculture et agro-industries : les exportations traditionnelles comme le café et le thé figurent en bonne place, aux côtés d’autres produits agricoles à haute valeur ajoutée (l’avocat, la banane, le vin de banane ou d’ananas, etc.) pour lesquels il existe une demande régionale. Les filières de transformation agroalimentaire (moulins, brasseries, production de jus…) pourraient trouver de nouveaux débouchés en EAC et en Afrique.
- Produits miniers : le Burundi possède des ressources minérales, notamment de l’or, du coltan et de la wolframite (minerai de tungstène). L’intégration facilite l’exportation de ces minerais vers les pays demandeurs du continent, pour peu que la production locale augmente et se formalise.
- Élevage et pêche : des produits comme le miel et ses dérivées, prisés sur les marchés voisins, ou encore le poisson du lac Tanganyika peuvent mieux s’écouler à l’échelle régionale. La libre circulation réduit les tracasseries pour exporter ces produits périssables.
- Tourisme et services connexes : grâce à ses sites naturels (parcs, chutes de la Karera, lac Tanganyika) et culturels (tambour burundais, etc.), le Burundi peut attirer davantage de touristes régionaux si les voyages intra-africains sont facilités. Le tourisme étant un secteur sans droits de douane, c’est surtout la coopération régionale (forfaits multi-destinations, promotion commune) qui pourra le dynamiser.
- Industries manufacturières légères : certaines industries locales naissantes ont une carte à jouer sur le marché est-africain. Par exemple, le Burundi exporte déjà vers la RDC et le Rwanda des produits comme de l’eau minérale, des savons et détergents, des bières et limonades, du textile (pagnes) et des cuirs.
La suppression des barrières tarifaires rend ces produits plus compétitifs à l’étranger et pourrait encourager l’investissement pour accroître la production.
Secteurs vulnérables : à l’inverse, l’ouverture des marchés met en concurrence directe les producteurs burundais avec ceux du reste de la région, ce qui peut fragiliser certaines filières peu préparées. Les industries locales embryonnaires, par exemple dans le textile-habillement ou la fabrication de biens de consommation courante risquent de souffrir face aux produits importés des voisins plus industrialisés (Kenya, Tanzanie), à moins de recevoir un soutien spécifique (protections temporaires, subventions à la modernisation, etc.). De même, certaines productions agricoles vivrières du Burundi, au rendement encore faible, peuvent être concurrencées sur le marché domestique par des denrées importées bon marché en provenance des pays à agriculture plus compétitive (le riz de Tanzanie, le maïs d’Ouganda, le lait en poudre du Kenya, etc.). Cela peut déstabiliser les revenus de nombreux petits agriculteurs locaux. Par ailleurs, le secteur naissant des services (banque, télécoms, distribution) pourrait voir entrer sur le marché burundais des entreprises régionales de plus grande envergure, rendant la vie plus difficile aux PME nationales moins outillées. On peut prendre l’exemple du commerce de détail : les supermarchés kenyans ou rwandais pourraient s’implanter à Bujumbura, accroissant la pression concurrentielle sur les petits commerçants. En somme, si l’intégration offre des opportunités sectorielles certaines, notamment pour les produits phares du Burundi, elle exige en parallèle des ajustements pour les secteurs moins compétitifs, sous peine de les voir perdre des parts de marché face aux importations régionales.
Comparaison avec les autres pays de la région
Le Burundi présente, en matière d’intégration économique, des performances plus modestes que la plupart des autres États membres de l’EAC, ce qui s’explique par la taille de son économie et des facteurs structurels. En volume absolu, ses échanges intrarégionaux sont les plus faibles de la communauté. À titre d’illustration, en 2014 les exportations du Burundi vers les partenaires de l’EAC étaient de l’ordre de 15 millions $, contre 1,51 milliard $ pour le Kenya. Cette différence d’échelle reflète le poids économique très disparate des deux pays, le Kenya disposant d’une base industrielle et agricole bien plus large que le Burundi. Même rapporté à la taille de chaque économie, le degré d’intégration commerciale du Burundi reste en retrait par rapport à certains voisins. En 2014, environ 17 % des exportations totales du Burundi étaient à destination de l’EAC, un niveau intermédiaire au sein du bloc, inférieur à celui de l’Ouganda (où près de 24 % des exportations allaient vers l’EAC), mais supérieur à celui du Rwanda (seulement 7 % à l’époque). Cela signifie qu’une part notable (mais non majoritaire) des échanges du Burundi se fait avec la région, alors que l’Ouganda dépend davantage du marché EAC et que le Rwanda, tout comme la Tanzanie, exportait surtout hors de l’EAC.
Les autres pays de l’EAC ont généralement mieux tiré parti de l’intégration jusqu’à présent. Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, en particulier, ont su développer des industries compétitives (agroalimentaire, textile, chimie, etc.) dont une fraction importante de la production est échangée au sein de la communauté est-africaine. Ils enregistrent des valeurs d’exportation intra-EAC bien plus élevées, soutenues par des investissements domestiques et étrangers attirés par le grand marché commun. Par exemple, le Kenya a attiré des usines de transformation textile qui exportent des vêtements vers les pays voisins, profitant des avantages de l’union douanière. À l’inverse, le Burundi, plus petit et sorti d’une instabilité politique dans les années 2005, se retrouve en queue de peloton en termes de commerce intra-régional. Son économie, encore très dépendante de produits primaires, n’a pas connu le même essor manufacturier que celle du Rwanda par exemple, qui malgré sa taille similaire a significativement augmenté ses exportations de biens vers la région ces dernières années (produits plastiques, matériaux de construction, services financiers, etc.). De plus, sur le plan du climat des affaires et de l’infrastructure, le Burundi accuse un retard qui le rend moins attractif que ses voisins pour les investisseurs cherchant à exploiter la plateforme régionale EAC, un point que reflètent les classements internationaux de compétitivité où le Burundi est distancé par le Kenya et l’Ouganda.
En ce qui concerne la ZLECAf, tous les pays de l’EAC (à l’exception du Sud-Soudan) ont ratifié l’accord et entament sa mise en œuvre. Le Burundi ne fait donc pas figure d’exception sur le plan formel. Cependant, sa capacité à exporter vers le reste de l’Afrique reste limitée comparativement à des pays comme le Kenya et la Tanzanie qui ont déjà des entreprises régionales fortes. Par exemple, le Kenya exporte largement vers l’Afrique australe et de l’Ouest (thé, café, produits manufacturés), tandis que les produits burundais sont encore quasi inexistants sur ces marchés lointains. La diversification géographique du commerce burundais progresse lentement et reste concentrée sur les pays limitrophes, là où des économies plus dynamiques de la région arrivent à conquérir des parts de marché sur l’ensemble du continent (en témoignent les marques tanzaniennes ou kényanes présentes jusqu’en RDC et au Nigeria). En résumé, comparé aux autres membres de l’EAC, le Burundi reste un petit acteur du commerce régional, dont l’intégration effective est encore naissante. Cette situation souligne l’importance pour le Burundi de renforcer ses capacités afin de combler son retard et d’émuler les réussites de ses voisins au sein de l’EAC et de la ZLECAf.
Défis et obstacles à surmonter
Malgré les avancées permises par l’intégration, le Burundi fait face à de nombreux défis qui freinent son plein essor dans l’Union douanière de l’EAC et la ZLECAf. Le premier obstacle tient à sa position enclavée et aux infrastructures de transport insuffisantes. Ne disposant d’aucun accès direct à la mer, le Burundi dépend des ports de Dar es Salaam (Tanzanie) et de Mombasa (Kenya) pour son commerce maritime, ce qui génère des coûts logistiques élevés et des délais importants. Les routes et corridors terrestres vers ces ports sont longs et parfois en mauvais état, renchérissant le prix des importations et exportations. En l’absence d’infrastructures adéquates, les coûts de transport demeurent très élevés, ce qui limite la compétitivité des produits burundais sur les marchés régionaux.
Comme le souligne la Banque mondiale, les frais de transport élevés dus au manque d’infrastructure « compliquent les échanges du Burundi avec l’Afrique de l’Est et le monde »
Un autre obstacle de fond est la faible compétitivité économique du Burundi par rapport à ses partenaires. Le tissu productif burundais est caractérisé par une faible productivité du travail, un coût de l’énergie élevé et un accès limité au crédit, ce qui renchérit les coûts de revient des produits locaux. Par exemple, l’électricité et le carburant coûtent plus cher au Burundi que dans plusieurs pays voisins, en raison de la dépendance aux importations énergétiques et d’une production nationale insuffisante, cela affecte négativement l’industrie. De plus, la structure des exportations demeure très peu diversifiée, centrée sur un petit nombre de produits de base (cafés, thés, minéraux) à faible valeur ajoutée. « La base exportatrice du Burundi est étroite et peu diversifiée, rendant le pays vulnérable aux chocs externes », notait la Banque mondiale dans une étude, insistant sur la nécessité d’élargir la gamme des produits exportés. Cette dépendance à quelques filières traditionnelles signifie aussi que le Burundi n’a pas encore développé de forte industrie manufacturière capable de concurrencer les importations régionales. Ainsi, en situation de marché libéralisé, ce sont souvent les produits des autres pays de l’EAC qui dominent, le Burundi peinant à proposer des alternatives locales compétitives.
Perspectives et recommandations
Malgré ces défis, des perspectives positives se dessinent pour le Burundi à condition de mettre en œuvre des réformes et stratégies appropriées afin de maximiser les bénéfices de l’intégration tout en en atténuant les effets indésirables. L’adhésion récente de la RDC à l’EAC élargit encore le marché régional disponible pour le Burundi et constitue un potentiel pour le commerce est-africain, compte tenu des vastes ressources et du bassin de plus de 90 millions de consommateurs qu’apporte la RDC dans la communauté. Ce développement offre au Burundi une opportunité inédite de s’insérer dans les chaînes d’approvisionnement de la RDC (par exemple en exportant davantage de produits alimentaires ou manufacturés vers ce voisin à forte demande) et de servir de pont commercial entre l’Afrique de l’Est et le cœur du continent. Sur le plan continental, la ZLECAf n’en est encore qu’à ses débuts, mais le Burundi a déjà élaboré une stratégie nationale de mise en œuvre qui a été validée en 2021. Il s’agit maintenant pour le pays de traduire cette stratégie en actions concrètes et de préparer activement ses secteurs public et privé à la concurrence et aux opportunités accrues. Comme le souligne l’IFC, après la ratification de l’accord, le Burundi doit « assurer une mise en œuvre complète et améliorer la compétitivité de ses exportations afin d’en récolter les bénéfices » de la ZLECAf.
En effet, une application effective des dispositions de la ZLECAf (règles d’origine, baisse tarifaire, mécanismes anti-barrières non tarifaires) permettra au Burundi d’accroître sa résilience aux chocs extérieurs et de catalyser les réformes internes nécessaires à une croissance de long terme.
Pour concrétiser ces perspectives, voici quelques stratégies et recommandations clés :
- Renforcer les infrastructures et la connectivité : Investir dans l’amélioration des routes, corridors et infrastructures logistiques reliant le Burundi à ses voisins est prioritaire. L’objectif est de réduire les coûts et délais de transport, par exemple en finalisant les projets de corridors routiers vers Dar es Salaam et en soutenant la connexion ferroviaire régionale. Le désenclavement physique du Burundi abaissera le coût des échanges et augmentera l’attractivité du pays pour les investisseurs. De même, le développement des infrastructures énergétiques (barrages hydroélectriques, interconnexions régionales) contribuera à fournir une électricité moins chère aux industries locales, améliorant ainsi leur compétitivité.
- Améliorer le climat des affaires et la compétitivité interne : Il est crucial de poursuivre les réformes pour créer un environnement propice aux entreprises. Cela comprend la simplification des procédures administratives, la lutte contre la corruption, et le renforcement de l’état de droit commercial. Faciliter l’accès au financement pour les entrepreneurs par des lignes de crédit PME, des garanties de prêt, la promotion des microfinances aidera à stimuler l’initiative privée. En parallèle, des programmes de formation et d’adoption technologique doivent être mis en place pour aider les PME burundaises à monter en gamme (meilleures techniques de production, standards de qualité, marketing). L’État, avec l’appui de partenaires, pourrait subventionner l’acquisition de nouvelles technologies et accompagner les entreprises dans la certification de leurs produits aux normes régionales. Renforcer les filières d’enseignement technique et les partenariats avec les pays de l’EAC (échanges de savoir-faire) ferait également partie des leviers pour accroître la productivité locale sur le long terme.
- Valoriser les secteurs porteurs et encourager la diversification : Le gouvernement burundais, en collaboration avec le secteur privé, devrait cibler les secteurs à fort potentiel d’exportation identifiés plus haut (agro-industrie, mines, tourisme, artisanat, petite manufacture) et élaborer des plans d’action pour les développer. Il s’agit notamment de soutenir la montée en qualité des produits (par exemple, améliorer le conditionnement du café, la transformation des fruits tropicaux en jus, la fabrication de produits artisanaux finis) pour conquérir de nouveaux marchés en Afrique. Des incitations à l’investissement (allègements fiscaux, facilitation d’accès aux terrains) pourraient attirer des capitaux dans ces secteurs et créer des coentreprises avec des partenaires de l’EAC. Exploiter la niche des produits « Made in Burundi » de qualité, comme le café de spécialité ou le miel bio permettra de différencier l’offre burundaise sur le marché continental. Par ailleurs, la promotion active des opportunités d’affaires au Burundi via les plateformes de l’EAC et de l’UA aidera à attirer des investisseurs étrangers prêts à utiliser le Burundi comme base pour exporter sous régime préférentiel vers toute l’Afrique (par exemple, une entreprise textile étrangère pourrait s’installer au Burundi pour exporter sans tarif vers l’UA grâce à la ZLECAf).
- Mettre en œuvre efficacement la stratégie nationale ZLECAf et sensibiliser les acteurs : Enfin, il est impératif d’opérationnaliser la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Cela implique de créer un organe de suivi réunissant gouvernement, secteur privé et société civile pour piloter les réformes liées à l’accord continental. Une large campagne de sensibilisation doit être menée auprès des opérateurs économiques (PME, coopératives, commerçants) pour les informer des règles du jeu de la ZLECAf (règles d’origine à respecter, tarifs préférentiels disponibles, etc.) et des opportunités qu’elle offre. Des ateliers pratiques, des guides d’exportation et un accompagnement personnalisé des entreprises désireuses d’exporter pourront accélérer l’appropriation de l’accord par le secteur privé. En outre, les autorités burundaises devraient collaborer activement avec les institutions de la ZLECAf pour défendre les intérêts du pays (par exemple sur la liste des produits sensibles à libéraliser plus lentement) et s’assurer que les dispositions de l’accord prennent en compte la situation des pays les moins avancés.
Parallèlement à ces recommandations, capitaliser sur la coopération régionale sera déterminant. Le Burundi peut profiter de sa position géographique stratégique au carrefour de l’Afrique de l’Est et des Grands Lacs pour devenir un pont commercial. Les responsables économiques nationaux doivent d’ailleurs encourager le Burundi à tirer les avantages de cette position pour « atteindre les marchés critiques de la région » et s’intégrer dans les réseaux d’échanges EAC. En développant, par exemple, la zone économique spéciale de Bujumbura et en améliorant la liaison commerciale vers l’est de la RDC, le Burundi peut se positionner comme une plaque tournante de certains flux de marchandises entre la Tanzanie, la RDC et le Rwanda.
En conclusion, l’intégration du Burundi au sein de l’EAC et de la ZLECAf s’ouvre sur des perspectives prometteuses de croissance et de diversification économique. Pour en récolter pleinement les fruits, le pays devra poursuivre et accélérer les réformes internes, investir dans ses infrastructures et son capital humain, et s’appuyer sur la solidarité régionale. Les bénéfices attendus en termes d’emplois, de baisse des prix pour les consommateurs, et de dynamisation du secteur privé valent la peine de relever ces défis. Le Burundi, bien qu’encore en retard par rapport à certains voisins, a l’opportunité de transformer progressivement son économie en s’ouvrant davantage à l’Afrique de l’Est et à l’Afrique tout entière, dans l’esprit du projet d’une Afrique intégrée, prospère et unie prôné par l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Les prochaines années seront décisives pour concrétiser cette vision au Burundi.
Par Bazikwankana Edmond